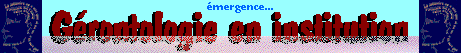
 12
pages,
12
pages,Pas plus chez les premières sociétés néolithiques que chez l'individu n'existe un instinct inné de propriété et de défense du territoire, mais l'apprentissage de la gratification, de la protection de l'équilibre biologique, du plaisir.
- À travers les textes de Platon et d'Aristote, on voit se mettre en place un idéal de vie individuelle et collective d'où le travail est exclu ou presque. La structure sociale grecque elle-même en est la preuve : l'ensemble des tâches directement liées à la reproduction matérielle est en effet entièrement pris en charge par des esclaves, et sa théorisation repose sur l'opposition loisir/travail. Toute la philosophie grecque est en effet fondée sur l'idée que la vraie liberté, c'est-à-dire ce qui permet à l'homme d'agir selon ce qu'il y a de plus humain en lui commence au-delà de la nécessité, une fois que les besoins matériels ont été satisfaits. Sans nourriture, sans vêtements, sans confort, pas de philosophie, de vie conforme à la raison
- A l'opposé de la sphère de la liberté, qui nous rapproche du divin, se déploie la sphère de la nécessité, qui est celle du travail, et en premier lieu du travail pénible, par essence serviles.
- Tout au long de la domination de l'Empire romain, et même jusqu'à la fin du Moyen Âge, la représentation du travail ne connait pas de bouleversement majeur.
- L'Empire romain n'accorde en effet aucune place particulière au travail, et persiste au contraire, sur le modèle grec, à le mépriser. Ce sont toujours les esclaves qui prennent en charge la majeure partie des travaux pénibles et la classification des activités, telle qu'on la trouve exposée par exemple chez Cicéron, se fait autour de l'opposition libéral/servile, les activités serviles étant celles qui sont effectuées sous la dépendance d'un autre, et les activités libérales, exercées pour elles-mêmes, étant au contraire le fait des hommes libres.
- « On regarde comme ignobles et méprisables les gains des mercenaires et de tous ceux dont ce sont les travaux et non les talents qui sont payés. Car, pour ceux-là, leur salaire est le prix d'une servitude» Et aussi celle des commerçants, qui se « spécialisent » dans les affaires et le négoce. De surcroît la nécessité sociale d'inventions qui permettraient de rendre plus faciles les travaux humains ne se fait pas sentir.
Au XVI° siècle, le nouveau mot de travail, tripalium, se substitue aux deux précédemment en usage, labourer et oeuvrer. On utilise donc pour désigner cette activité un mot qui permettait jusque-là de nommer une machine à trois pieux souvent utilisée comme instrument de torture ! Au XVII° siècle, le mot continuera à signifier gêne, accablement et souffrance, humiliation.
- En 1776, la publication des Recherches sur les causes de la richesse des Nations, d'Adam Smith, constitue une fantastique rupture par rapport au contexte intellectuel qui prévalait alors et est contemporain du début du travail salarié en manufacture.
- Nous appartenons donc depuis peu de temps (deux cent ans) à des sociétés fondées sur le travail. Ce qui signifie que le travail, reconnu comme tel par la société,c'est-a-dire rémunéré, est devenu le principal moyen d'acquisition des revenus permettant aux individus de vivre, mais qu'il est aussi un rapport social.
D'où la double évolution dont Smith prend acte d'une part, le travail est désormais le moyen de l'autonomie de l'individu, d'autre part. il existe une partie de l'activité humaine qui peut être détachée de son sujet et qui ne fait pas obligatoirement corps avec celui-ci, puisqu'elle peut être louée ou vendue. Smith n'invente pas cette nouvelle conception du travail : il ne fait que donner force aux différents éléments qui se mettent en place sous ses yeux pour constituer le travail salarié.
Pourquoi la richesse est-elle soudainement apparue comme la véritable fin que doivent poursuivre les sociétés ? Pourquoi cette énergie consacrée à mettre en évidence les lois de son accroissement ? Pourquoi cette soudaine attention portée à l'intérêt individuel, devenu une véritable catégorie de l'économie politique naissante ?
Le désir d'abondance est le principe qui donne son unité, de l'extérieur à la société : tous les individus sont habités par ce désir. Il est désormais le premier moteur social, qui meut l'ensemble des individus par « amour ». Il donne de cette manière une première sorte d'unité au corps social. Mais ce désir structure de surcroît toute la société. A partir de lui, l'économie définit en effet les lois naturelles de l'enrichissement et en déduit l'ordre social et la structure des rapports sociaux, entièrement déterminés au sens fort du terme, par la capacité des hommes à produire et échanger. Les relations sociales, les liens entre les individus, les places, la hiérarchie sociale ne sont pas le résultat du choix des individus, mais celui d'un déterminisme strict, dont l'économie dit les lois.
- La réaction de tous les pays occidentaux devant l'augmentation massive de la productivité depuis les années 1950 a donc été double : d'abord considérer le travail humain ainsi rendu inutile comme un mal social majeur en continuant de l'appréhender à travers les mêmes catégories qu'auparavant (et particulièrement celle du chômage) ensuite mobiliser des moyens pour trouver des emplois à tout prix. L'expression « à tout prix » doit être entendue ici dans son sens littéral. « A tout prix » signifie qu'il est légitime, nécessaire et vital de créer des emplois, même temporaires, même sans contenu, même sans intérêt, même s'ils renforcent les inégalités, pourvu qu'ils existent. Ceci s'explique par le fait que nos gouvernements, mais aussi nos sociétés, considèrent le chômage comme un mal social d'une extrême gravité, un cancer qui dévore la société et conduit les individus qu'il touche depuis trop longtemps à la délinquance et les sociétés elles-mêmes à des réactions imprévisibles. Le chômage, c'est l'une des causes de l'arrivée de Hitler au pouvoir, c'est la révolte sociale... Tout cela est bien connu. Mais le bien connu, c'est l'évidence quotidienne dans laquelle nous vivons et que nous ne pouvons donc plus voir. Or, si nous prenons quelque recul, nous conviendrons qu'il est tout de même curieux qu'au lieu de prendre acte de cette augmentation de la productivité et d'y adapter les structures sociales, nous nous soyons arc-boutés pour conserver ce que les années 1968 dénonçaient comme le comble de l'aliénation,« perdre sa vie à la gagner » : le travail.
- Quand aurons-nous le sentiment d'avoir atteint l'abondance, le véritable bien-être ou la totale coïncidence à nous-mêmes, si ce n'est dans un terme mythique de l'histoire, toujours repoussé en
- fait ?
- Nous avons conservé le mouvement, la tension et tout ce qu'ils déterminent en sachant secrètement que nous n'atteindrons jamais l'objectif que nous sommes censés poursuivre. Nous ne parlons plus aujourd'hui d'abondance ou de richesses, mais de compétitivité, de besoins toujours plus nombreux à satisfaire, de menace extérieure.
- Nous ne savons plus quoi faire du temps libéré car nous ne savons plus ce que signifie la contemplation ou l'action, qui portent le principe de leur plaisir en elles-mêmes. Nous n'imaginons plus d'autre rapport au monde et à l'action que celui de la production et de la consommation : nous ne pouvons plus nous exprimer que par la médiation d'objets ou de prestations et de productions, nous ne pouvons plus agir qu'en consommant.
- Dans l'esprit des auteurs qui la défendent, cette thèse recouvre plusieurs éléments, qui sont le plus souvent confondus et que l'on peut classer sous quatre chefs principaux : le travail permet l'apprentissage de la vie sociale et la constitution des identités (il nous apprend les contraintes de la vie avec les autres) ; il est la mesure des échanges sociaux ; il est la norme sociale et la clef de contribution-rétribution sur quoi repose le lien social ; il permet à chacun d'avoir une utilité sociale : chacun contribue à la vie sociale en adaptant ses capacités aux besoins sociaux ; enfin, il est un lieu de rencontres et de coopérations, opposé aux lieux non publics que sont le couple ou la famille.
- Les discours de valorisation du travail qui s'appuient sur cette argumentation pèchent cependant : en prenant le travail comme modèle du lien social, ils promeuvent une conception réductrice de ce lien.
- Qu'est-ce que le lien social ?
- Tentons de comprendre si c'est le travail en soi qui est générateur de lien social ou s'il n'exerce aujourd'hui ces fonctions particulières que «par accident». Réglons d'un mot la question de la norme : dans une société régie par le travail, où celui-ci est non seulement le moyen d'acquérir un revenu, mais constitue également l'occupation de la majeure partie du temps socialisé, il est évident que les individus qui en sont tenus à l'écart en souffrent. Les enquêtes réalisées chez les chômeurs ou les RMistes et qui montrent que ceux-ci ne veulent pas seulement un revenu, mais aussi du travail, ne doivent pas être mal interprétées. Elles mettent certainement moins en évidence la volonté de ces personnes d'exercer un travail que le désir de vouloir être comme les autres, d'être utiles à la société, de ne pas être assistés.
- On ne peut pas en déduire un appétit naturel pour le travail et faire comme si nous disposions là d'une population-test qui nous permettrait de savoir ce qu'il en est du besoin de travail.
- Mais, nonobstant la question de la norme, le travail est-il le seul moyen d'établir et de maintenir le lien social, et le permet-il réellement lui-même ?
- Cette question mérite d'être posée, car c'est au nom d'un tel raisonnement que toutes les mesures conservatoires du travail sont prises : lui seul permettrait le lien social, il n'y aurait pas de solution de rechange.
- Or, que constatons-nous ? Que l'on attend du médium qu'est le travail la constitution d'un espace social permettant l'apprentissage de la vie avec, les autres, la coopération et la collaboration des individus, la possibilité pour chacun d'eux de prouver son utilité sociale et de s'attirer ainsi la reconnaissance.
- Le travail permet-il cela aujourd'hui ? Ce n'est pas certain, car là n'est pas son but: il n'a pas été inventé dans le but de voir des individus rassemblés réaliser une oeuvre commune. Dès lors, le travail est, certes, un moyen d'apprendre la vie en société, de se rencontrer, de se sociabiliser, voire d'être socialement utile, mais il l'est de manière dérivée. Les collaborations et les rencontres occasionnelles qui s'instaurent dans les usines ou dans les bureaux constituent une manière d'être avec les autres. mais il s'agit somme toute d'une forme de sociabilité assez faible. L'utilité sociale peut sans doute parfois se confondre avec l'exercice d'un travail, mais cela n'est pas nécessaire.
- Autrement dit, le travail permet aujourd'hui l'exercice d'une certaine forme de sociabilité, mais c'est essentiellement parce qu'il est la forme majeure d'organisation du temps social et qu'il est le rapport social dominant, celui sur lequel sont fondés nos échanges et nos hiérarchies sociales, et non parce qu'il aurait été conçu comme le moyen mis au service d'une fin précise, l'établissement du lien social. Les arguments en sa faveur sont d'ailleurs le plus souvent des raisonnements par l'absurde bien sûr, le travail n'exerce peut-être pas ces fonctions au mieux ; bien sûr, il n'est fondamentalement pas fait pour cela, mais nous ne disposons d'aucun autre moyen.
- Mais à cette première conception s'oppose une autre définition du lien social, radicalement différente, qui voit en lui quelque chose de plus substantiel dont l'origine ne peut se trouver dans la production. Cette tradition parcourt les siècles, d'Aristote à Habermas, et considère que le lien social n'est pas réductible au lien économique ou à la simple production, parce que la vie, et en particulier la vie en communauté est «action et non production».
- La production matérielle ou même la production tout court, n'est pas la seule manière d'être ensemble, de faire une oeuvre société: il faut aussi compter avec la parole, le débat, les institutions L'être ensemble se parle et le lien politique n'est pas réductible au lien économique.
- Comment parviendrons-nous à définir ce qui, conçu comme un enrichissement du point de vue «privé», constitue en réalité un appauvrissement pour l'ensemble de la société. si nous ne disposons pas d'un inventaire de la richesse sociale ?
- Autrement dit, si nous n'avons inscrit nulle part que l'air pur, la beauté, un haut niveau d'éducation, une harmonieuse répartition des individus sur le territoire et la paix, la cohésion sociale, la qualité des relations sociales sont des richesses, nous ne pourrons jamais mettre en évidence que notre richesse sociale peut diminuer alors que nos indicateurs mettent en évidence son augmentation.
- En effet, il s'agit d'une richesse qui n'est pas réductible aux points de vue individuels, qui ne peut pas être produite par un acte ou des actes individuels, puisqu'elle concerne justement tous les individus ou résulte de leur acte commun. Ce n'est donc qu'à condition de disposer d'un inventaire de la richesse sociale que nous pourrions savoir si celle-ci augmente vraiment d'une année sur l'autre. À cette condition, nous pourrions éviter de faire passer ce qui n'est qu'une usure ou une diminution de la richesse sociale pour une augmentation de celle-ci.
- À cette condition seulement, nous pourrions considérer comme faisant partie intégrante de la richesse sociale ce qui renforce la cohésion ou le lien social, ce qui est un bien pour tous, comme l'absence de pollution ou de violence, l'existence de lieux où se rencontrer, se promener, réfléchir, mais également toutes les qualités individuelles : l'augmentation du niveau d'éducation de chacun, l'amélioration de sa santé, le bon exercice de toutes ses facultés, l'amélioration de ses qualités morales et civiques.
En dehors du travail, le lien social tient compte aussi de besoins psychologiques.
« L'ensemble des phénomènes sociaux n'est pas réductible aux seules dimensions économiques : la comptabilité nationale, qui mesure en termes monétaires la création et les échanges de droits économiques. n'a pas pour objet de mesurer le bien-être, le bonheur ou la satisfaction sociale » écrivent les comptables nationaux dans leur présentation des méthodes du Système élargi de comptabilité nationale. C'est croire que l'on peut dissocier l'image de la réalité que donnent les instruments de mesure de cette réalité elle-même.
La distinction entre prix et valeur : les objets matériels auraient un prix, et à ce litre pourraient entrer dans la catégorie « officielle » de la richesse, mais les oeuvres de Victor Hugo auraient une valeur tellement supérieure qu'elles ne devraient pas avoir de prix, qu'elles ne devraient même pas être prises en compte, puisqu'elles participent d'un autre ordre...:
- Le lien social peut s'analyser comme le résultat de la constitution de relations d'entraide et de réciprocité aux fins de protection et de promotion mutuelle des individus qui s'y engagent.
- Marcel Mauss, dans son ouvrage Essai sur le Don (1925) étudiant le lien social et l'échange dans les sociétés primitives, le relie à une triple obligation : donner, recevoir, rendre.
- Celui qui donne prend l'initiative de fonder l'échange et manifeste ainsi sa puissance. Celui qui reçoit est l'obligé. C'est la troisième obligation, celle du rendre qui, par la réciprocité qu'elle amène, crée le lien. L'obligation à rendre assure que les partenaires maintiennent une relation qui leur profite mutuellement. La réciprocité est une norme qui stabilise les relations sociales et assure leur continuité par un déséquilibre toujours maintenu entre ce à quoi on a droit et ce que l'on doit.
Godbout parle ainsi de l'homme moderne : « Pseudo-émancipé du devoir de réciprocité, croulant sous le poids de l'accumulation de ce qu'il reçoit sans rendre, (il) devient un grand infirme. Un être vulnérable... fuyant le cycle donner-recevoir-rendre de peur de se faire avoir, aseptisant le cycle en rapports unilatéraux, objectifs, précis... alors que rendre c'est donner ; donner-recevoir-rendre, c'est chaque fois poser l'indétermination du monde et le risque de l'existence; c'est chaque fois, faire exister, la société, toute société ».
Ce schéma peut-il nous permettre d'éclairer la question du lien social avec la vieillesse dans notre société. Il implique de poser la question : qu'a donc à rendre le vieux ? Ou encore que doit-il à la société ?
Il a à rendre sa vieillesse...
Il ne sert à rien de nier la vieillesse, de chercher à grignoter une ou deux années. Il faut laisser les vieux remplir leur rôle. Leur rôle qui est de rappeler la limite à l'autre bout de la vie. Le vieux est là, avec sa vieillesse, son existence de plus en plus indicible.
Le vieux nous renvoie, nous rend la question du sens de la vie. Recevoir cette question, c'est accepter de renouer le lien social avec cet âge, faire un chemin d'humanité.