Retour au Grenier
à texte
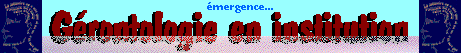
Le
médecin, la médecine et la mort  5
pages
5
pages
Le médecin, la médecine et
la mort
Il y a un siècle, les maladies importantes
étaient presque toutes mortelles et la conscience de la fin
se faisait jour au fil de l'évolution.
Les médecins
ne guérissaient pas, ils se contentaient d'imposer une
hygiène et d'apaiser les souffrances autant que possible.
Ils avaient ainsi une fonction morale qu'ils partageaient avec le
prêtre le médecin de famille, comme le
curé, était l'assistant du mourant.
La médecine
moderne contribue largement à escamoter la mort. Les
ressources thérapeutiques actuelles sont telles qu'elles
nous permettent de faire comme si la médecine allait avoir
réponse à tout ; la mort s'efface de notre
conscience, remplacée par la maladie. Et les
règles du jeu se trouvent bouleversées : des
survies incroyables sont obtenues, la durée du processus de
mort devient très variable, en partie en fonction des
techniques. Celles-ci sont exercées dans les
hôpitaux et le mourant est ainsi
aliéné, abandonné au pouvoir
médical.
Cette
évolution est si nette que de nos jours sept
français sur dix terminent leur existence à
l'hôpital.
La
dégradation de la famille et de son environnement porte un
préjudice certain au mourant en ne laissant pas
d'alternative au mourir hospitalier.
Le médecin
plus particulièrement le médecin
d'hôpital se substitue à la famille et
à l'entourage social, il devient le nouveau «
maître de la mort »
Et pourtant, la mort est
bien un événement auquel sa formation ne l'a pas
préparé ; les études de
médecine sont devenues essentiellement scientifiques, le
reste est à apprendre sur le tas. La maladie constitue un
problème à régler duquel
découlera une solution technique ; le diagnostic est parfois
même la principale préoccupation.
Le rôle des
médecins est parfaitement assimilé par les
proches, qui revendiquent à présent une mort de
qualité, souvent sous forme d'un départ paisible
et sans souffrance. Mais la culture médicale est
réfractaire à cette mission et il arrive ainsi
que le mourant soit abandonné par les médecins,
qui «ne peuvent plus rien pour lui» : la visite
passe au-dessus de la chambre, l'affaire est devenue celle des
infirmières, un problème de « nursing
».
Ces changements qui
confrontent maintenant « plus souvent qu'à son
tour » le médecin avec la souffrance ont aussi
pour conséquence une altération voire une perte
de la conscience de la mort.
La
conscience de la mort
- La maladie grave entraîne
généralement une rupture de communication : entre
le médecin et le patient qui va mourir, c'est le silence, le
mensonge ou une discrétion de bon aloi.
- Le grand malade est
souvent infantilisé, c'est particulièrement net
vis-à-vis des vieillards. On fera semblant jusqu'au bout.
Comme l'écrivait Tolstoï, dans La mort
d'lvan lllitch, on lui avait fait « le mensonge
qu'il n'était que malade et pas mourant, mensonge qui
rabaissait l'acte formidable et solennel de sa mort. »
- Alors que jusqu'au XX° siècle on se
faisait un devoir d'éclairer le malade, c'est devenu de nos
jours une règle morale que de ne pas annoncer la
vérité. Plus encore, si malgré tout le
mourant a deviné, il fait semblant de ne pas savoir; la
bienséance exige qu'il reste discret et naturel.
Jankélévitch parle aussi de «
disparaître pianissimo et pour ainsi dire sur la pointe des
pieds ». C'est encore ce qu'écrit plus brutalement
Pierre Desproges qui, se sachant atteint d un cancer du poumon,
intitule un chapitre de son sarcastique manuel de savoir-vivre
« Sachons mourir sans dire de conneries ».
- Philippe Ariés (1975) résume ainsi la
situation actuelle : « La mort d'autrefois était
une tragédie souvent comique où on jouait
à celui qui va mourir ; la mort d'aujourd'hui est une
comédie toujours dramatique où on joue
à celui qui ne sait pas qu'il va mourir. »
- L'entretien de cette illusion part
généralement d'un bon sentiment
réciproque, celui de ne pas faire de mal. Il ne faudrait pas
croire cependant que les malades consentent toujours à ce
jeu : souvent au contraire, ils lancent à certains
interlocuteurs des appels qu'il faut savoir entendre. Pour dialoguer
à ce moment, il est indispensable qu'une
familiarité singulière se soit établie
bien avant la phase ultime.
- La révélation d'une mort prochaine
est à vrai dire souvent dramatique ; elle suscite des
réactions de dénégation, de
révolte, de dépression,
précédant une acceptation qui parfois ne viendra
jamais.
- L'entourage et les médecins redoutent ces
réactions qui, à elles seules motivent certaines
prescriptions de calmants.
- Le mourant ne devrait pas être laissé
dans l'ignorance, la mort ne doit pas le prendre par surprise. Certains
auront en eux la force de «tenir le coup»
jusqu'à un événement pour eux capital
(naissance, retour...). D'autres auront le temps de se
réconcilier avec eux-mêmes ou avec d'autres,
d'exprimer des désirs, de trouver un sens à cette
vie qui s'en va... D'aucuns feront même des projets, bien
sûr à court terme, mais qui témoignent
de leur désir de vivre encore ; ainsi dans ce dialogue
célèbre de Platon avec Socrate,
condamné à mort :
- « À quoi te
sert, Socrate, d'apprendre à jouer de la lyre puisque tu vas
mourir ? »
- Socrate : « A jouer de la lyre avant de
mourir. »
- Les sociétés traditionnelles avaient
coutume d'entourer le mourant et de recevoir ses communications
jusqu'à son dernier souffle ; ce n'est plus le cas dans les
hôpitaux et les cliniques où se passe maintenant
la mort. Le mourant infantilisé n'est plus
écouté : sa parole n'a ni sens ni
autorité. Nos mourants n'ont plus ni statut ni
dignité comme l'écrit le Dr Maurice Abiven dans
un éditorial retentissant de La Presse médicale.
Les mourants de cette fin de siècle sont des clandestins,
des marginaux dont on commence à peine à
découvrir la détresse.
La mort escamotée
- Autrefois, on naissait et on mourait en public ;
aujourd'hui, on meurt caché, souvent isolé.
- La mort disparaît de notre conscience,
remplacée par la maladie que la médecine est
à même de traiter. Ainsi le mourant-malade
disparaît-il dans « le secret grisâtre
des hôpitaux et des cliniques ».
- Le corps est escamoté et n'est plus objet de
respect ni de culte. Il n'y a plus lieu de faire étalage
d'une quelconque peine, le deuil est réprouvé.
Cette évolution favorise indiscutablement une tendance
sociale à se débarrasser plus activement des
mourants ; les prises de position envers l'euthanasie se multiplient
aux États-Unis comme en Europe ; ce débat ne doit
pas être méconnu. Il n'est que temps de rendre aux
mourants leur place, car les rites de mort, sont faits pour la paix des
vivants.
Le sens de la vie et de la
mort
Vivre, c'est évoluer vers la mort. La naissance et la mort
sont des expériences très proches l'une de
l'autre et comportent une structure de base identique : celle du
passage d'un état à un autre, du changement
radical de milieu.
Dans le sein de sa mère l'enfant
découvre un milieu chaud et liquide qui répond
à ses besoins du moment. Lorsqu'il arrive au monde, il
plonge dans un univers totalement différent et inconnu.
Lorsqu'une personne sent ou sait qu'elle va mourir, elle vit
un épisode identique à la naissance; elle
s'apprête à faire un plongeon dans une dimension
totalement inconnue.
Un jour ou l'autre, nous prenons conscience des limites de
notre horizon. Nous consacrons des années à notre
développement professionnel, à l'harmonie de
notre vie de couple, à la création de liens
d'amitié, à nos différents
apprentissages, etc., jusqu'au jour où il faut se
détacher et se rendre à l'évidence que
nous ne faisons que passer.
L'apprentissage de la vie se déroule à
travers des projets, des expériences plus ou moins heureuses
qui peuvent nous aider à croître ou, au contraire,
qui peuvent nous détruire. Lorsque nous avons
été impuissants à résoudre
un problème ou que nous avons été
placés face à la mort d'un être cher,
nous avons pu ressentir le besoin de chercher un sens à la
vie.
Qu'un deuil nous frappe ou que nous ayons à
accompagner un malade en phase terminale, nous nous interrogeons : Cela
a-t-il un sens? et quel sens ?
Aussi bien sur les événements que sur
la vie en général, cette recherche fait partie de
notre destinée. Dans son ouvrage, Le désir infini
de trouver un sens à la vie, Harold Kushner affirme :
«Au lieu de ressasser le fait que rien ne dure, acceptez-le
comme une des vérités existentielles, et apprenez
à trouver un sens et un but au transitoire, à la
joie fugace. Apprenez à savourer l'instant, même
s'il ne dure pas. En fait, apprenez à le savourer parce
qu'il n est qu'un instant et qu'il ne durera pas.»
C'est le "Carpe Diem" du grecs Horace et des pages roses du
dictionnaire : mets à profit le temps présent.
À chaque degré de notre devenir, la
mort peut prendre un sens différent: elle peut nous sembler
l'ennemi juré contre lequel il faut se battre ; elle peut se
comparer à un grand détachement que nous sommes
prêts à accepter ; elle peut
représenter le seuil qu'il faut dépasser pour
naître à une autre réalité.
Elle signifie presque toujours une «grande
expérience.»
Il sera plus facile pour la personne qui aura
cultivé durant sa vie l'ouverture à l'inconnu de
s'adapter à l'instant qui s'offre à elle. La
présence à la vie est la meilleure
préparation à la mort. Elle signifie
être ouvert à tout ce qui peut advenir sans rien
refuser, pas même, ni surtout, la mort.
Pour plusieurs, la mort n'est qu'une transition ; elle
évoque un départ, une mutation, un passage vers
une autre dimension. Elle peut être remplie d'espoir, comme
elle peut être vécue dans l'angoisse d'une vie qui
nous quitte. Percevoir la mort comme un « aboutissement
négatif » équivaut à avoir
des regrets de ne rien laisser ou de n'avoir pu achever ce qui devait
être. L'individu qui considère la mort comme un
« aboutissement positif » s'est peut-être
senti utile ; il a pu recevoir et donner de l'amour et il sait qu'il
restera toujours dans le souvenir de ceux qu'il a aimés. Sa
mission est achevée, il peut partir en paix.
Faire face à la maladie et à la mort
constitue, pour certains une remise en question de l'image de soi et de
l'identité à travers les émotions.
La mort est perçue comme un
déchirement : les liens unissant la personne mourante
à ceux qu'elle aime se brisent.
Accepter la mort, c'est accepter la loi du
dépassement et fixer son regard au-delà des
limites physiques.
La mort peut, en effet être une occasion
d'éveil spirituel. Nombreuses sont les personnes qui
découvrent que la vie a un sens et qu'elles n`ont jamais
été aussi vivantes qu'au moment de partir. Elles
ont consenti à plonger dans leurs richesses
intérieures, c'est- à-dire les
expériences vécues et acceptées, et le
détachement graduel dont elles ont su faire preuve leur
apporte un senti- ment de paix et de
sérénité.
La personne mourante invite ceux qui l'entourent
à s'interroger sur leurs buts prioritaires. Elle peut leur
permettre d'affronter le présent et le futur, car elle vit
une situation immédiate. Elle les ramènera dans
l'instant, en les incitant à vivre chaque jour pour
lui-même, sans peur ni angoisse. Elle leur apprendra
peut-être une certaine sagesse à
l'égard de leur façon de vivre.
Assister une personne en fin de vie, c'est l'aider
à donner un sens personnel à son existence qui
s'achève.
Quel est notre destin ?
« A travers toute l'histoire, les philosophes, les
théologiens et le commun des mortels se sont posé
ces questions ; la spéculation seule peut y
répondre, car nous n'avons aucun moyen de
vérifier la justesse de nos jugements à ce sujet,
et quand nous saurons la réponse, il sera trop tard pour
changer le cours de nos vies. Le plus raisonnable semble donc de
chercher des réponses qui nous donnent la paix et la force
de vivre des vies signifiantes.»
L'humanitude
- L'histoire des hommes est ainsi celle de leur construction
par eux-mêmes. À l'humanité
reçue, ils ont ajouté un ensemble de
caractéristiques que l'on peut appeler "l'humanitude ".
L'élément le plus décisif de cette
humanitude est sans doute la capacité de s'interroger. Tout
d'abord sur l'univers qui nous entoure : pour les animaux, seuls
existent les faits ; pour les hommes, ces faits deviennent des sources
d'interrogation.
- Pourquoi, comment de tels événements
se produisent-ils ? La science peu à peu apporte des
réponses ; mais son cheminement aboutit à
élargir le champ des questions encore ouvertes. Le jeu, est
d'autant plus fascinant qu'il est sans fin. Si provisoires qu'elles
soient, ces réponses sont source d'efficacité ;
le savoir apporte le pouvoir.
- Maîtriser par quelques équations les
phénomènes
électromagnétiques permet de
développer toute une industrie, d'apporter partout
énergie motrice et lumière. Ces pouvoirs
progressivement accumulés ont tout d'abord
été reçus avec une satisfaction sans
mélange. Au début du XVII siècle, le
philosophe Francis Bacon pouvait affirmer : "Le but de la science est
de réaliser tout ce qui est possible".
- Mais, quelques siècles plus tard, nous sommes
obligés de mettre une sourdine à cet optimisme et
de constater, comme Albert Einstein au soir d'Hiroshima :" Il y a des
choses qu'il vaudrait mieux ne pas faire. " Car les questions
essentielles ne portent pas sur l'univers, elles portent sur
nous-mêmes, et elles sont d'autant plus angoissantes que nous
les savons en notre pouvoir. Nous en sommes arrivés au point
ou, après avoir pendant quelques milliers de
siècles construit inconsciemment l'humanitude, il nous faut
faire un projet explicite pour l'avenir de notre espèce.
- Demain sera ce que nous déciderons aujourd'hui :
acceptons-nous de faire disparaître l'humanité
dans une apocalypse nucléaire ? Acceptons-nous de fabriquer
des clones humains servant de réserves de pièces
de rechange ?
- Acceptons-nous de conditionner des petits d'homme dans
l'acceptation d'un destin étriqué ?
- Il faut répondre à ces interrogations
éthiques. Cette éthique, pourquoi ne pas la
développer en fonction de la
spécificité humaine ?
- Toutes les autres espèces se contentent de ce
que la nature leur a octroyé seuls nous avons
été capables d'être plus que
nous-mêmes, selon l'expression de Saint Augustin.
- La fonction
essentielle de tout groupe d'hommes, famille, village, nation,
humanité dans son ensemble, est d'apporter à tout
petit d'homme qui apparaît, et qui n'est encore à
sa naissance qu'une promesse d'homme, le moyen de devenir un homme.
C'est-à-dire d'intérioriser et d'enrichir, au
cours des quelques décennies de son parcours personnel,
l'ensemble de ce que les hommes qui l'ont
précédé ont accumulé :
interrogations, émotions, existences.
- Ainsi peut-on
s'efforcer de fonder une éthique sur la nature
même de l'Homme, sur le constat de l'évolution qui
l'a produit. Plutôt que de juger le bien et le mal en
fonction des interdits prononcés par une puissance
extérieure, s'exprimant par le truchement d'une
"révélation", n'est-il pas plus digne de la
condition humaine d'en juger d'après la
conformité à l'objectif fondamental : faire
entrer en humanitude tous les hommes sans exception ?
-
Réintégrer
le pouvoir de penser au sein du pouvoir de vivre, comme la
capacité de vivre peut être ramenée
à la capacité d'être ? Nous sommes tout
entiers, corps et âme, des produits de l'univers ; en
l'acceptant nous ne nous enlevons aucune dignité.
Nous donnons
à l'univers une immense dignité, nous nous
émerveillons devant lui puisqu'il a
été capable de nous produire. Nous nous
émerveillons surtout devant nous-mêmes, capables
de prendre le relais et de réaliser des demain plus
prodigieux encore.
Demain n'existe pas
mais nous savons qu'il existera, et qu'il dépend de nous. De
moi, de vous.
-
Dr Lucien Mias
mai 1999
Retour au Grenier
à texte
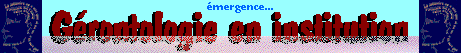
 5
pages
5
pages