Retour au Grenier
à texte
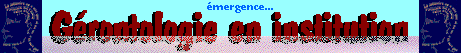
La culture qu'est ce ?  9 pages
9 pages
Le mot du mois,
d'Alain Rey dans la Revue
médicale Tout Prévoir de
février 2006
définissait la culture...
« Le mot
"culture" fut longtemps synonyme de
cette révolution néolithique qui fit passer
l'espèce humaine de la cueillette à l'«
agriculture ». Puis vint la métaphore humaniste,
au XVI'
siècle, la « culture» devenant le
développement des connaissances et des aptitudes
individuelles, avant d'englober, d'abord en allemand [ Ku/tur : les
Français s'en moquèrent ], tous les aspects
intellectuels et idéologiques d'une civilisation. Pas
d'adjectif, pendant longtemps, pour cette idée et pour ce
nom.
C'est sous l'influencé de la langue anglaise qu'apparaissent
au milieu du XX° siècle les activités et
les
besoins « culturels ».
Puis le mot entre dans
le champ
administratif, avec les missions, les relations, les
attachés,
les centres, plus "culturels" les uns que les autres. Cette culture
plutôt officielle, avec ses maisons et ses ministres, veut
englober les activités de création, artistiques
et
littéraires. Ou bien vise-t-elle à les encadrer ?
Mais
une autre valeur des mots culture et culturel, grâce aux
savants, anthropologues et sociologues, acquiert une plus grande
importance. Ce qui est « culturel» correspond alors
à toutes formes acquises d'un comportement collectif et ne
s'oppose qu'aux résultats de
l'hérédité
biologique. Du coup, non seulement sont culturels l'art, la musique,
la poésie, mais les habitudes, les manières de
vivre,
de se vêtir, de se nourrir, de réagir, de se
comporter.
Et voilà le culturel doté d'une valeur
anthropologique
universelle, mais infiniment variée sur la
planète,
comme le sont les langues par rapport au langage. »
Alain
Rey, est co-auteur, avec Danièle Morvan, du Dictionnaire
culturel en langue française, 2005.
La culture c'est ... la création ? l'intelligence ? Le savoir ?
Pas
seulement ...
Ce mot recouvre deux
réalités complémentaires : les cultures particulières qui nous différencient ; la culture universelle,
qui nous relie.
Dans les deux approches, la culture s'oppose à
l'état de "nature" (l'homme asocial, n'ayant pas acquis des
normes de comportement).
La
culture différentielle (ou particulière)
- La
culture
différentielle (particulière) est «
l'ensemble des structures sociales, des manifestations artistiques,
religieuses, etc. qui définissent un groupe par rapport
à un autre ». La culture hellénistique,
inca, arabe, française, catalane, alsacienne etc... en sont
des exemples
- Tout
individu, comme
sujet social, est inséré dans un
réseau relationnel où se tissent, à
divers niveaux, des liens d'identification et de rejet.
- À
l'identification familiale ou clanique se superpose...
- - une identification
civique autour d'un contrat social
concrétisé par les textes constitutionnels,
- - une identification sur la base d'une mise en
situation concrète dans le processus de production
économique,
- - une identification
culturelle, souvent
inconsciente, qui manifeste l'intériorisation de
valeurs, mais aussi de comportements quotidiens portant sur l'usage du
langage, du corps, du temps, de l'espace selon des codes
partagés avec les autres permettant une
compréhension sans heurt.
- La mixité
culturelle, que l'on veuille ou non,
remet en question les processus d'identification culturelle, parce
qu'elle nous met en présence d'un "autre" qui ne partage pas
la culture particulière qui nous est propre.
Or, des valeurs communes, issues de la pensée
libérale et démocratique, permettent la
convivialité interculturelle : on reconnaît
à chaque culture la légitimité de sa
présence dans l'espace public et politique. On accepte que
l'autre, que l'on ne comprend pas immédiatement, soit un
être rationnel jouissant en conséquence de
l'autonomie et du respect dû à l'être
humain.
La mise en pratique
de ces principes de coexistence pacifique n'est pas
spontanée : elle rend nécessaire un travail
préalable d'intériorisation consciente des
valeurs de tolérance démocratique que l'appareil
d'état (école, armée, associations...
) se charge, normalement, d'assurer.
En effet, le repli sur l'identité culturelle et clanique est
un réflexe spontané : on se retrouve entre soi,
dans un espace social où l'effort
d'intercompréhension est réduit au minimum et
bénéficie de la meilleure gratification.
Dans l'espace public,
les heurts se manifestent lorsque l'un ou l'autre groupe, par son
comportement culturel, paraît violer les règles
comportementales régissant l'identité
civique.
La culture universelle (ou générale)
- C'est
«
le développement de certaines facultés de
l'esprit par des exercices appropriés »
et
- « l'ensemble des
connaissances acquises qui permettent de
développer le goût, le sens critique, le jugement
»
Les deux définitions sont
complémentaires
- Il existe donc une culture
différentielle,
identitaire, culture du «marquage» (peintures du
visage, scarifications...) qui signe l'appartenance à un
groupe ; et une culture universelle, plus
générale, qui procède de tous les
savoirs (savoir, savoir-être, savoir-faire) et qui signe
l'appartenance à l'espèce humaine, capable de
jugement, de tolérance, de respect, d'amour.
Les deux définitions ne sont pas en opposition mais en
position de complémentarité.
- Certaines valeurs d'intérêt local,
certaines coutumes dont l'ancienneté n'excuse en rien leur
caractère universellement inadmissible (excisions africaines
par exemple) ne sont pas des faits de culture mais des actes de
domination, le plus souvent "matchistes".
D'un
parfum de salon mondain à... l'Internet
- La culture c'est, pour beaucoup, un bien grand mot,
enveloppé d'un parfum de salon mondain. Mais il y a aussi
une manière «agricole» de l'aborder, par
le verbe «cultiver».
Se cultiver,
c'est tracer des sillons en soi qui griffent notre
personnalité profondément, successivement.
Si l'on ne veut pas
rester en état de répétition des
idées anciennes que l'on nous a transmises, il faut braver
l'extérieur, franchir
le fleuve pour s'exposer de l'autre côté, du
côté de l'autre. Et cet autre, avec ses savoirs propres,
produit en nous une autre personne dont les idées reçues
ont laissé la place aux idées comprises.
- La culture ne provient pas uniquement des ouvrages de
réflexion philosophique, littéraire, politique ou
autre... Il n'y a pas une bonne littérature
cérébrale et une bonne littérature de
loisir.
Il faut prôner la liberté de
l'itinéraire. Il est illusoire de vouloir contraindre la
curiosité, le pédagogue ne peut que s'efforcer de
l'éveiller et promouvoir chez l'apprenti-lecteur l'autonomie
d'une pensée qui pratiquera d'elle-même le
discernement.
-
On peut estimer que
l'informatique
nous offre en cette matière un outil spectaculaire :
l'hypertexte accessible notamment par Internet.
L'hypertexte, dans
l'absolu, c'est la possibilité en ouvrant un texte sur
l'écran d'un ordinateur, avec un geste aussi simple que le
«clic» de la souris, de sauter d'un fragment de
texte à un autre.
Internet réalise en quelque sorte partiellement ce
rêve de relier tous les textes (mais aussi des images, des
sons) existant sur la planète situés sur des
serveurs dans des pays différents. L'utilisateur peut mettre
son grain de sel, déterminer lui même des liaisons
avec d'autres textes.
Il est donc
possible de réaliser en temps réel,
c'est-à-dire, dans l'immédiateté de la
lecture, un parcours entre de multiples livres ou autres sources
d'informations.
- Il est raisonnable de
penser que se cultiver puisse vraiment se démocratiser par
ce biais .
LES
VALEURS,
l'ÉTHIQUE ET LA
MORALE
« En
médecine comme ailleurs, il y a des
libertés d'un jour et des siècles de servitude.
Le
carcan retombe et l'humanité souffrante n'y gagne rien. Pour
qu'il y ait progrès, il faudrait que les médecins
acquièrent une très haute notion de leur
devoir.C'est
avoir foi dans une évolution morale parallèle
à
l'évolution technique de l'humanité que de
l'espérer. Avoir foi dans l'avenir de l'humanité,
c'est
croire, en notre domaine, que le médecin continuera de
soigner
ses frères non seulement avec sa science, mais aussi avec
son
coeur. Ce mode d'exercice ne s'enseigne pas, il se vit. » Paul Milliez, Pr de médecine
Ce sont les valeurs qui
façonnent la culture, le visage de
la société et finalement, la personne
elle-même.
Elles influencent la façon dont la personne agit ou
réagit.
Les valeurs constituent la conscience de chacun, la nature des
relations interpersonnelles mais aussi la manière dont les
hommes se perçoivent, leurs objectifs dans la vie et la
finalité de la vie elle-même.
"L'attachement aux
valeurs" ou le "rejet des valeurs"
résultent dès lors d'un choix fondamental quant
au sens
à donner à son existence.
Or, c'est justement
là que réside le grand
problème d'aujourd'hui.
Beaucoup ne disposent pas d'une base éthique, d'une
référence de discernement. Pour eux, les valeurs
ne
reposent plus sur une assise ou, en tout cas, sur une assise solide.
Cette absence d'assise est à l'origine de la crise
éthique actuelle. La multitude
différenciée des
impressions et des opinions, le rythme rapide de l'existence, le
développement technocratique, les solutions de
facilité
dans la recherche d'un bien être souvent matériel,
entraînent une banalisation des valeurs, une
indifférence éthique.
Certains ont pu croire que la biologie pourrait non seulement faire
disparaître de nombreux maux mais nous donnerait
également une nouvelle définition de la personne.
D'une
part, la biologie n'échappe pas à la
création
d'autres maux d'autre part, elle débouche sur une impasse et
une angoisse quant à la réponse de qui est
l'être
humain.
Qu'adviendra-t-il de la personne ? Parviendra-t-on à
établir que la pensée n'est qu'une
réaction
chimique particulière ? Que le mécanisme de la
différenciation des cellules embryonnaires
peut-être
démonté et remonté comme une horloge ?
Que tout
organe malade ou déficient peut-être
remplacé
comme toute pièce d'une voiture ?
La tentation est grande de réduire l'homme à
l'homme en
le coupant de sa relation à «Dieu» et
par
conséquent de sa relation aux autres.
POUR UNE MORALE SANS HAINE BASÉE
SUR DES VALEURS D'HUMANITUDE
Source : A. Etchegoyen, La
valse des
éthiques, François Bourin, Paris, 1991, 244 p.
«
Quand on nous parle aujourd'hui d'un retour de la morale,
on risque d'entendre la paraphrase d'un slogan politique malheureux : au secours, la morale revient.
C'est le mot qui revient, mais son contenu a
changé
sous l'effet de l'histoire et sous le coup des critiques. Les
discours ont été impuissants à tuer ce
qui est
un ressort très profond de l'homme. Mais ils auront
peut-être contribué à nettoyer la
morale de ses
impuretés bourgeoises.
La
morale future peut s'organiser autour de trois principes
fondamentaux: le poids de la
parole, la
cohérence des discours et des actes, la
générosité. Ces trois concepts font
système car
ils résument l'essentiel de nos désirs face
à
l'autre. Ils inspirent ce que Kant appelait le respect et ils ont
assez d'universalité pour intégrer des concepts
que
nous admettons sans toutefois les avoir assez fondés.
On donne souvent un tour moral à
de simples règlements intérieurs ou
déontologies qui méritent
sans cesse
d'être confrontés à de plus hautes
exigences,
dites morales.
Pour nous engager dans cette voie nous avons à retenir tout
ce
pour quoi la morale bourgeoise a prêté aux pires
dérisions et critiques.
- En premier lieu, il nous faut, sans conteste, supprimer
toute référence essentielle aux choses du sexe.
Certes, elles n'échappent pas aux effets de la morale, comme
tout ce dans quoi s'engage l'homme, mais elles ne sauraient ni
être au principe ni produire une focalisation (on pourrait
dire une obsession) particulière. Il est essentiel que nous
rompions avec la tradition qui nous fait qualifier d'immorale la vie de
don Juan, la santé de Carmen ou la performance de Casanova.
- En second lieu, toute connivence avec l'ordre
social doit être balayée.
L'interrogation morale ne peut partir d'un ordre tel qu'il est :
l'entreprise répète cette erreur lorsqu'elle
nomme éthique ce qui assure sa performance sur le long
terme. La vraie morale reste indifférente aux belles
machines, et son rôle n'est pas de huiler des rouages ni
d'apporter sa contribution au fonctionnement d'une organisation. Toute
morale née de l'ordre est un ordre donné par cet
ordre, étouffant les critiques et le
doute. L'interrogation morale, au contraire, tire sa
légitimité de la conscience dans sa relation aux
autres consciences ou dans son regard du Visage d'Autrui: elle ne
consacre aucune puissance, aucun pouvoir, aucun territoire. Les
repères qu'elle donne aux hommes sont des noeuds
d'où surgissent des interrogations, des
frontières à partir desquelles on
soupçonne et se soupçonne, une
démarcation dont on cherche la ligne.
Sans doute est-il de bonne
guerre pour certains de chercher à satisfaire notre exigence
morale avec ses souvenirs, dans la nostalgie des interdits et des
autorités.
Telle est la tentation
réactionnaire qui ne manquera pas
d'apparaître dans ces temps qui courent, et qui,
déjà, entame son discours pétri dans
le sang de la détresse humaine, dans le virus du sida.
- C'est pourquoi nous savons qu'une troisième
condition est peut-être encore plus urgente car elle
prévient les deux autres : la morale devra
éviter la haine.
Dans sa généalogie de la morale, Nietzsche nous a
légué une analyse décisive et appris
une vérité : la morale commune était
habitée par la haine. Elle n'en était pas
entièrement pénétrée, mais
la laissait affleurer au détours de ses accusations et au
fronton de ses inhibitions. Durant des siècles la morale a
été animée de façon
essentielle, par le ressentiment, par le plaisir d'accuser , par
«la haine vindicative de l'impuissance», pour
reprendre son expression favorite. Il manquait à la
bonté d'être positive : elle s'exhibait avant tout
dans la haine de la méchanceté. « Tu es
méchant donc je suis bon. »
Ainsi Nietzsche résumait-il le raisonnement des faibles,
toujours avides de mépriser les êtres capables de
faire tout ce pour quoi ils ne se sentent pas assez forts. La remarque
est puissante: même au coeur des dénonciations les
plus vertueuses de la corruption, n'y aurait-il pas ce ressentiment
très vil de l'impuissance ?
En nous débarrassant de cette morale accusatrice qui ne sait
que nier, dénoncer, en somme hurler avec les loups, nous
arracherons la mesquinerie et la petitesse qui pesaient sur tous nos
actes. Cette morale était négative dans son
principe, dans l'avenir elle sera positive, affirmative, ou ne sera pas.
Si Nietzsche admirait le Christ, c'était pour
révérer en lui le créateur de valeurs
actives, affirmatives.
Dans le discours des plus irresponsables contempteurs de
la morale, cette négation d'une négation n'a
jamais su devenir une affirmation. On avait alors peur de revendiquer
et d'assumer un concept de morale trop disqualifié. La
morale ne peut s'enraciner dans la haine, ferment de toute guerre.
Lasse de dénoncer, il lui faut aujourd'hui
énoncer.
Il n'est point besoin de préceptes pour la guerre, la morale
à venir est un enseignement de paix.
Kant et le Christ se rejoignent : l'un qui entamait son
grand ouvrage moral par le concept de «bonne
volonté», comme paradigme de la conscience
rationnelle commune de la moralité; l'autre qui, dix-huit
siècles plus tôt, affirmait: « Paix sur
la terre aux hommes de bonne volonté. »
L'exigence de morale est aujourd'hui une exigence de paix.
Dès qu'elle prend un visage haineux, dès qu'elle
suggère le bourreau, elle se disqualifie comme morale.
Tel était précisément le
cas des discours qui s'obnubilaient sur le sexe ou sur l'ordre social.
Ils étaient surtout stimulés par une peur,
toujours mauvaise conseillère. On ne rassemble pas dans la
haine mais dans son contraire, qui l'ignore, superbement.
- Quand on nous parle aujourd'hui d'un retour de la morale,
on risque d'entendre la paraphrase d'un slogan politique malheureux :
au secours, la morale revient. C'est le mot qui revient, mais son
contenu a changé sous l'effet de l'histoire et sous le coup
des critiques. Les discours ont été impuissants
à tuer ce qui est un ressort très profond de
l'homme. Mais ils auront peut-être contribué
à nettoyer la morale de ses impuretés bourgeoises.
- La
morale future peut s'organiser autour de trois
principes fondamentaux : le poids de la parole, la
cohérence des discours et des actes, la
générosité.
- Ces trois concepts font système car ils
résument l'essentiel de nos désirs face
à l'autre. Ils inspirent ce que Kant appelait le respect et
ils ont assez d'universalité pour intégrer des
concepts que nous admettons sans toutefois les avoir assez
fondés.
Nous devons par là même retrouver les
caractéristiques d'un humanisme qui va de pair avec la
mondialisation de tous nos rapports sociaux et moraux.
Bien des vertus particulières pourraient et pourront s'en
déduire, que d'autres, en d'autres lieux et d'autres
oeuvres, expliqueront avec plus de pertinence.
- La parole
d'abord.
-
C'est, je le crois
profondément, le principe de la relation entre tous les
hommes. L'écrit reste ponctuel, somme toute assez rare,
tandis que nous parlons sans cesse à autrui. Dans chaque
existence, nous bavardons, discutons, dialoguons: nos paroles peuvent
dire le pire et le meilleur.
Nous les distinguons donc de la parole, engagement qui prend une
signification beaucoup plus forte. La langue française rend
bien compte du poids de la parole. Elle s'associe
immédiatement à l'honneur ; elle se donne et se
tient. Chacun apprécie l'autre qui n'en a qu'une. Lui
redonner tout son sens, c'est restaurer la confiance et donner un poids
de principe aux relations avec les hommes.
Un
monde sans parole est un monde profondément
démoralisé car nous en avons besoin pour
étayer nos espérances et notre
solidarité. Nous ne devons plus nous contenter
d'écrire et d'attendre les signatures au bas de contrats
validés par des hommes de loi ou des agents de la force
publique.
- La
dégradation de la parole, publique et privée, est
constatée de tous côtés.
Si nous examinons le discrédit du politique, nous y
retrouverons pour une bonne part cette protestation contre une parole
qui se dénude de sens.
- La parole n'est et ne
restera dévaluée que dans sa contradiction avec
les actes. Le caractère péjoratif de l'expression
« en paroles » signifie qu'on oppose à
la parole une négation par les actes.
- Les linguistes
insistent sur les verbes qu'ils appellent performatifs et qui
parcourent notre langue commune: « Dire, c'est faire
», pour reprendre un titre d'Austin. Ainsi agit le maire en
disant: « Je vous déclare unis par les liens du
mariage », ou encore l'animateur en annonçant:
« Je déclare cette séance ouverte.
» L'acte est la parole même. Il faut donc, avec
attention, considérer la parole comme un acte, la rendre
performative dans le maximum de cas.
- On dira que le langage et la communication entre les hommes
supposent bien des modalités. Ainsi le bavardage qui peut
sembler futile est-il une propédeutique à la
communication. Certes, tous les mots ne sont pas pesés.
Toutes les paroles mesurées auraient alors une
gravité trop sérieuse et sinistre. Or nous aimons
la légèreté chantante des gens du Sud
pour qui les paroles ont peu de poids, au regard des traditions plus
nordistes. Mais la parole en jeu est celle qui engage les hommes les
uns vis-à-vis des autres. Il faut pour cela que
l'émetteur et le récepteur (comme on dit dans la
communication), c'est-à-dire deux hommes, aient le sentiment
de cet engagement.
- La parole, en ce sens, est un acte
généreux : elle nous implique et, dans son
engagement, nous fait donner quelque gage. Car notre
société et nos consciences manquent surtout de
générosité. C'est, me semble-t-il, le
concept crucial de nos interrogations à venir. Il fut
souvent oublié par nos moralistes et l'on tend à
l'obérer dans des discours trop abstraits.
-
Le seul qui en ait
fait le centre de son oeuvre est Descartes, justement lui, qu'on
dénonce d'ordinaire, dans les entreprises, comme le parangon
d'une rationalité un peu demeurée. Le
Traité des passions l'aborde dans le concept et dans les
actes qui en font pour lui la plus grande vertu : « N'estimer
rien de plus grand que de faire du bien aux autres hommes et de
mépriser son propre intérêt pour ce
sujet. »
-
On ne
s'étonnera pas de le trouver aujourd'hui repris, dans des
contextes divers, par Michel Serres ou Emmanuel Levinas, avec
simplicité.
- La
générosité demeurait
trop marginale dans la morale perdue. Elle se déduit mal de
la haine, de la crainte du sexe et de la sauvegarde de l'ordre. Nous
haïssions la morale infâme, nous l'aimerons
généreuse.
- La
générosité est
nécessairement absente des éthiques en vogue. Le
défaut est de principe, inscrit au coeur du slogan :
« Ethic pays ». Qu'il nous faille une telle
certitude pour songer à la moralité est un signe
éclatant: les éthiques sont d'avares placements
de pères de famille. Nous y confondons la
moralité avec le calcul, l'intelligence et, souci majeur,
l'image: « Ce n'est pas pour la montre que notre
âme doit jouer son rôle » (Montaigne). On
voudrait éviter la prise de risque en nous proposant une
morale de comptable : à l`actif, l'image et le long terme ;
au passif, quelques sacrifices sur le court terme.
- Or toute morale
nouvelle ne peut échapper à la
responsabilité essentielle de tout être,
c'est-à-dire au risque et aux multiples épreuves
dans lesquelles nous engage notre liberté. Faisant de cette
responsabilité sa fondation, elle n'exige pas d'en
être dégagée, elle l'assume et s'engage
au contraire pleinement dans l'épreuve nécessaire
du risque.
- La morale nous fait
vivre au-dessus de nos moyens sans nous enfermer dans les taux de
réussite qui sont autant de taux
d'intérêt.
La générosité nous attend au tournant
de cette morale qu'il faut appeler par son nom sans craindre, comme
l'écrit Levinas, que « cela fasse rire la
société évoluée
», confondant le simple et le simplet. Le concept de
générosité est
générique: dans sa forme comme dans son contenu,
il engendre les autres concepts et toutes les pratiques qui en
découlent.
-
Généreux
comme concept par tout côté qu'on l'aborde :
« Nous n'avons pas besoin de philosophie grandiose pour
savoir, dès le jeune âge, que la
générosité n'a pas
d'équivalent dans les vertus de qualité haute.
Aussi bien, le mot qui la désigne exprime l'engendrement;
non que le généreux soit né,
seulement, ou gentil au sens de la noblesse, mais parce que le
versement d'un flux précieux hors de soi mime ou commence
les deux seuls actes qui vaillent, la production des oeuvres et
l'amour, qui quelquefois procrée la vie. Mère ou
père d'un autre et vite de soi, le munificent
crée ou le généreux vivifie alors que
l'avare meurt, au sens exact, de saisissement. Seuls les prodigues
produisent et nous ne naissons qu'à mesure de dons
» (Michel Serres).
Le concept de générosité
mérite un sort particulier. Il dit la dépense
contre l'économie, l'ouverture contre la clôture,
le flux contre les vannes. Celui qui interroge la terre, en ses
semailles, dit le sol
«généreux» quand il lui
répond.
- Un
tempérament généreux mesure mal ses
efforts, évitant d'être parcimonieux dans ses
engagements. Il peut errer, mais, dit encore ailleurs Michel
Serres,
- « comme
l'être et le néant, le mal et le
bien se mesurent par le petit et le grand ».
- Dans les concepts qui
courent dominent des maîtres mots qui interdisent toute
objection (antiracisme, droits de l'homme). Nous avons à les
reprendre dans l'ordre des choses et dans l'ordre des raisons. Ils nous
maintiennent au lointain, qui peut alors devenir l'inverse du prochain.
Nos causes sont devenues mondiales pour n'être plus
près de nous.
C'est en partant du Visage de l'Autre, dans sa concrétude
proche, que je peux légitimement penser au lointain. Dans
l'ordre des raisons lui-même, l'antiracisme est bien de
nature morale, mais il demande à être
porté par une ambition plus haute que la seule haine de tous
les racistes. En évacuant la morale, nous avons
oublié le Visage d'Autrui, comme le
répète sans cesse Emmanuel Levinas depuis
quelques années.
-
Avant de
considérer des terres étrangères, il
faut envisager le plus proche. La modalité de la
proximité réside dans la
responsabilité, mais une responsabilité qui ne
peut se réduire au champ de l'intervention
économique: « La rencontre d'autrui est
d'emblée ma responsabilité pour lui. »
L'entreprise n'est qu'un lieu particulier dans lequel se vit cette
rencontre. Il s'y trouve aussi d'autres hommes envisageables. Qu'elle
édicte en son sein des règlements
intérieurs relève du droit de chaque organisation
à l'intérieur de son propre espace de pouvoir.
- La morale
est à hauteur différente.
- Il n'est pas
étonnant que le mot d'éthique,
déformé, vulgarisé et
instrumentalisé, y connaisse quelque succès :
face au risque authentique d'une morale mal famée,
l'éthique introduit une prudente distance. « Ce
qui est important, c'est que la relation à autrui soit
l'éveil et le dégrisement » (E.
Levinas).
- Nous sortirons ainsi du narcissisme dévastateur
que produit une mauvaise psychanalyse: à se regarder et
s'ausculter sans cesse, à se demander « si l'on va
bien ou mal », on oublie que le bien et le mal sont d'autres
catégories, d'un autre ordre.
- La morale qui sera la
nôtre demeurera à hauteur d'homme. Être
responsable, c'est donner une réponse qui s'appelle
générosité; elle ressemble
à cette « petite bonté »
qu'évoquent ensemble Levinas et Grossman. « Vertu
enfantine », « n'allant que d'homme à
homme, sans traverser les lieux et les espaces où se
déroulent les événements et forces
».
- La
générosité peut être notre
repère nouveau, comme le sortir de soi qu'elle implique de
génération en génération,
comme le don dénué de stratégie.
La générosité s'apprend. Elle
se nourrit mal des seuls exemples héroïques : d'une
part, ils sont toujours suspects de leur souci d'une image positive ;
d'autre part, l'éducation morale ne doit pas faire appel
à l'imitation, servile et dangereuse, qui n'est pas la
méthode d'un homme libre.
La générosité a grand
besoin de l'apprentissage scolaire. L'ancienne morale,
répudiée, passait par l'art de faire honte, et
les leçons en sont perdues tant cette technique choque notre
temps: il nous faudra des leviers plus positifs, au-delà de
la menace.
Nous pouvons déjà en avoir quelque
idée : depuis bien longtemps, les parents et les
éducateurs se satisfont de voir leurs ouailles se
dépenser.- C'est dans cette voie
qu'il nous faut aller : se dépenser, se donner du mal, c'est
bien, pense-t-on à juste titre; c'est toujours se
démener, c'est-à-dire s'éduquer, comme
le confirme l'étymologie. Se démener est
d'ailleurs un joli mot, privilégié, puisqu'il
existe seulement sous la forme pronominale et dit bien la part du sujet
dans la dépense.
La générosité peut ainsi se vivre
dès l'école, dès l'enfance, mais elle
n'est pas la fatalité d'une jeunesse trop
flattée, censée en avoir l'intuition
immédiate. Car la
générosité passe avant tout par une
exigence toujours recommencée qui ne s'inscrit pas dans un
âge de la vie. On y peut prendre du plaisir, comme le
soulignait Kant du devoir accompli. L'école est, en droit,
un cercle vertueux de générosités qui
s'alimentent les unes les autres. Y parler de morale permettrait d'y
reconnaître le bien qui exige d'être
nommé. Généreux, le bien
nommé.
-
Les médias
aussi sont nécessaires: la
générosité, pour être
commune, doit être communiquée.
Nous ne saurions
faire l'impasse sur les grands moyens de communication.
Aucune morale ne peut maintenant reprendre pied sans ce consensus,
cette intercompréhension qu'elle contribue à
développer. C'est pourquoi les choix doivent être
clairs.
La
télévision privée, pour sa part,
souffre d'un saisissement viscéral : elle craint toujours de
distribuer trop, de « voler trop haut », d'offrir
de l'excès quand on se satisferait de soap opera.
L'institution
privée ne peut combler notre attente car elle n'a pas en
charge cette communication sans laquelle toute morale nous
échappe, faute de consensus nécessaire. Il n'y a
aucune raison d'attendre des chaînes privées
qu'elles s'acquittent des missions qui ne sont pas les leurs (les leurs
sont ailleurs). Il faut de bons commerçants, mais aussi
d'autres hommes qui pensent et diffusent au-delà du profit
des annonceurs en droit d'obtenir ce qu'ils payent.
Des
chaînes authentiquement publiques pourraient s'assigner des
missions à la hauteur des hommes et des citoyens que nous
sommes.
-
La morale, avec son
acception périmée, demeurait dans l'opprobre, en
évoquant la censure. La
générosité en est tout le contraire :
elle substitue la pléthore au défaut,
l'excès à la coupure. Elle ne se
réduit guère à l'espace d'un
Téléthon, sur l'unique affirmation :
«Vous êtes tous formidables.» Une
chaîne peut être de galère comme de
solidarité.
Dans la mesure où les grands médias publics font
aujourd'hui une grande partie de notre lien social, il est
décisif qu'ils répondent à de
généreuses exigences sans se contenter de
répercuter des notions ambiantes.
Il ne s'agit pas d'envahir les ondes et les images de discours
vertueux: la télévision pourrait être
édifiante, dans sa pratique même, sans inflation
de discours péremptoires.
Elle pourrait par exemple nous apprendre à comprendre les
autres, prochains et lointains, à les regarder
au-delà du plaisir sadique et de l'émotion
visuelle : la générosité commence par
un regard détourné de soi-même et se
cultive dans cette occupation du temps. »
- Bibliographie
- A. Etchegoyen, La valse des éthiques, François Bourin, Paris, 1991, 244 p.
- Lucien Mias
- 28/04/2006
Retour au Grenier
à texte
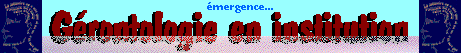
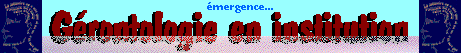
 9 pages
9 pages